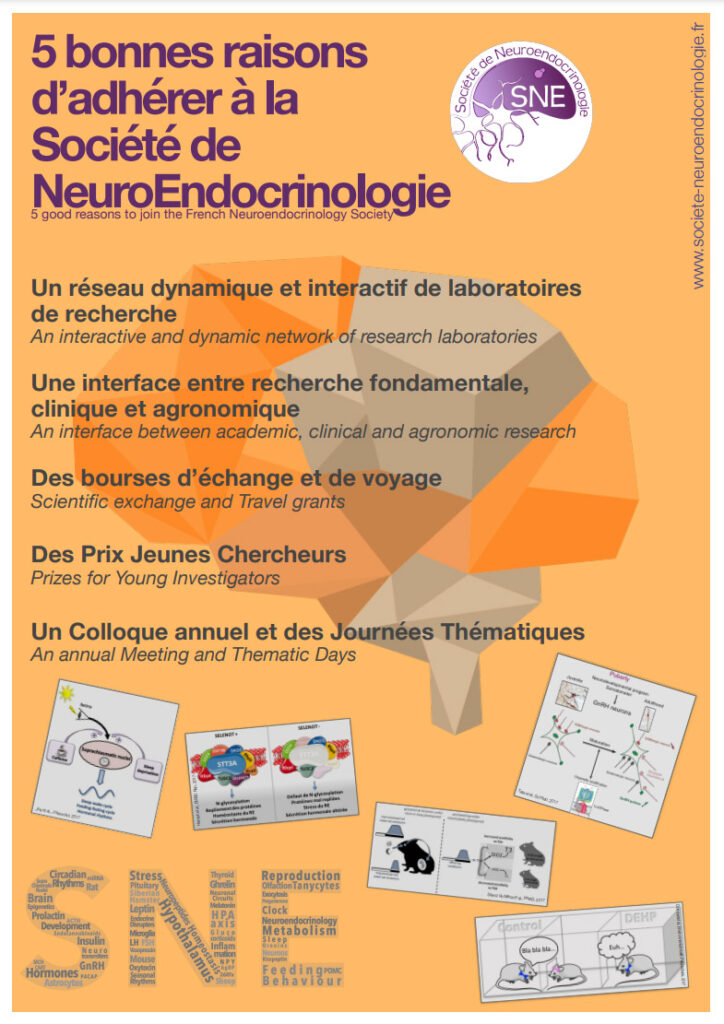Jacques Epelbaum
U.159 INSERM 2 ter rue d’Alésia, 75014, Paris.
Certains historiens ont suggéré que le grand (à tout point de vue !) pharaon égyptien Akhénaton, inventeur du monothéisme aux alentours du XIVeme siècle avant notre ère, était acromégale, en raison de son prognathisme marqué et de ses grosses lèvres. Ceci reste à démontrer mais, dans la bible, le cas de Goliath paraît moins sujet à caution. De nos jours, certains deuxième ligne de rugby ou basketteurs de la N.B.A. remplissent tous les critères de cette maladie pourtant invalidante qui est, dans l’immense majorité des cas, dûe à une tumeur somatotrope de l’adénohypophyse.
Si on peut tracer l’acromégalie jusqu’à l’aube des temps historiques, ce n’est que très récemment, qu’on a commencé à comprendre l’organisation particulière et les fonctions multiples du complexe hypothalamo-hypophysaire, ainsi que des hormones et des neurohormones qui y jouent un rôle.
On peut raconter cette histoire en cinq étapes (mot qui s’impose, puisque la GH est désormais un des produits favoris des cyclistes du Tour de France !) :
– l’hypophyse
– l’hypothalamus
– le système porte
– la neurosécrétion
– et les neurohormones hypothalamiques.
Première étape : l’hypophyse
Dans l’antiquité, pour Galien, la glande pituitaire (de pituita : flegme, mucus) est une fosse d’aisance pour les déchets dérivés de la distillation des esprits animaux du cerveau. Le mucus était censé filtrer par les ouvertures de l’os ethmoîde dans les cloisons nasales.
Au XVIIeme siècle, sur des bases anatomiques, Conrad Victor Schneider de Wittenburg conclue, en 1655, que les ouvertures dans la plaque cribiforme de l’os ethmoïde sont remplies par les nerfs olfactifs et que des fluides ne peuvent donc passer du crane vers le nez.
Ceci est confirmé en 1670 par Richard Lower d’Oxford, à partir de l”observation d’un cas d’hydrocéphalie et par une série d’expérience sur des cadavres. Après injection d’eau dans les veines jugulaires, il observa que le volume du liquide intracérébroventriculaire augmentait considérablement alors qu’ aucun fluide n’apparaissait dans les cavités nasales. Ce fut également Lower qui imagina que des substances pouvaient être conduites des ventricules à l’hypophyse à travers l’infundibulum, pour être “distillées” dans le flux sanguin.
La reconnaissance de l’origine embryonnaire duale de l’hypophyse, à partir de la plaque neurale et de l’épithelium buccal ,s’étendit sur la majeure partie du 19eme siècle. En 1838, Martin Heinrich Rathke de Königsberg décrivit sa fameuse poche, s’étendant du toit du stomodeum jusqu’à une extension ventrale du plancher du diencéphale. La même année, la théorie cellulaire était proposée pour les plantes par Schleiden et, l’année suivante, Schwann l’étendait à l’animal. Les méthodes histologiques se développant, de nombreux auteurs décrivaient les glandes endocrines (sans conduit excréteur), spécialisées pour les sécrétions internes.
En 1853, Claude Bernard conceptualisait la constance du milieu intérieur et notait que les tissus et les organes peuvent décharger des substances dans le sang. L’idée était développée par Brown-Séquard et d’Arsonval, avec la notion que les sécrétions internes servent à coordonner les fonctions corporelles. Enfin, Bayliss et Starling découvraient la première hormone en 1904 : la sécrétine.
Si l’histologie montrait clairement la nature glandulaire du lobe antérieur (pars distalis) de l’hypophyse, la situation était moins claire pour le lobe nerveux. Les techniques de colorations argentiques développées par Golgi et modifiées par Cajal montraient un riche faisceau de fibres que Cajal considéraient comme des fibres sensorielles entourant l’épithelium de la pars intermedia. Jusque dans les années vingt, des auteurs comme Camus et Roussy considéraient la neurohypophyse comme un fragment nerveux atrophié et d’autres, comme Bailey et Bremer, mettaient en question l’importance fonctionnelle de l’hypophyse. Pourtant, dès 1921, Evans et Long, avaient rendu des rats géants en leur injectant journellement des extraits d’adénohypophyse bovine. De plus, les femelles traitées présentaient des ovaires de taille très augmentée, avec des masses de corps jaune et une suppression du cycle oestrien.
Rétrospectivement, les relations fonctionnelles entre l’hypophyse antérieure et la croissance peuvent être traçées jusqu’en 1864. A cette date, Minkowski avait montré que le syndrome d’acromégalie, décrit par Pierre Marie, était accompagné dans presque tous les cas (99%) d’une tumeur hypophysaire. Malheureusement, il en déduisit, de manière erronée, que la tumeur devait représenter une perte de fonction et donc que le syndrome était dû à une absence d’action de l’hypophyse. Les premières hypophysectomies expérimentales, réalisées sur le chien, montraient que les animaux ne pouvaient survivre plus de quelques jours. Paulesco en conclut que l’hypophyse était essentielle à la vie. Cependant, d’autres auteurs montrèrent que l’hypothalamus était également touché par la chirurgie. Aschner, opérant sur des chiots, réussit à obtenir des temps de survie de plusieurs mois en absence totale d’hypophyse mais sans dommage au cerveau. Les chiots ne grandirent pas. Il n’était cependant pas clair, si ce défaut de croissance était dû à une hormone particulière, puisque des problèmes métaboliques étaient également observés chez les animaux, rendus cachectiques par la chirurgie. De plus, le cortex surrénalien, les organes reproducteurs et la thyroïde étaient également endommagés.
Enfin, à la fin des années 30, l’existence de six hormones antéhypophysaires était établie :
Ces hormones controlaient la croissance (GH) , les gonades (LH/FSH), la glande mammaire (Prl), la thyroide (TSH) et le cortex surrénalien (ACTH). Les progrès de l’histologie classique dans les années cinquante, puis de l’immunohistochimie dans les années soixante-dix, montrèrent qu’à chaque hormone correspondaient un type de cellules hypophysaires, à la notable exception des cellules gonadotropes qui peuvent produire à la fois de la LH et de la FSH. En revanche, le concept “un précurseur polypeptidique / une hormone” n’est pas valide : la POMC, le précurseur commun de l’ACTH et de la MSH, donne naissance à chacune de ces deux hormones dans les cellules corticotropes du lobe antérieur et les cellules mélanotropes du lobe intermédiaire, respectivement.
Deuxième étape : l’hypothalamus
Dès 1901 et la description originale du syndrome d’obésité lié à une dystrophie urogénitale par Frohlich, la controverse entre les rôles respectifs de l’hypophyse et de l’hypothalamus était lancée. Une tumeur cystique intracranienne, vraisemblablement un craniopharyngiome, fut drainée et le patient récupéra. A partir des années quarante, les progrès de la neurochirurgie permirent de montrer qu’une atteinte sélective de l’hypothalamus sans dommage de l’hypophyse, produisait une atrophie génitale et une obésité. Des données fonctionnelles furent aussi obtenues. Ainsi, dans l’ovulation réflexe induite par le coït chez la lapine, il fut montré d’une part que l’hypophyse n’était nécessaire que dans l’heure suivant la copulation, ce qui indiquait une sécrétion rapide, et d’autre part que l’anesthésie du vagin empêchait l’ovulation, ce qui montrait que le système nerveux était directement impliqué. Plus précisément, des stimulations cérébrales, puis directement au niveau de l’hypothalamus, déclenchaient l’ovulation; à condition que la tige hypophysaire ne soit pas interrompue.
Troisième étape : le système porte
Les vaisseaux sanguins de la tige hypophysaire furent décrits pour la première fois en 1930 par Pietsch et Popa et Fielding, chez le lapin. De manière erronée, ces auteurs conclurent que le flux sanguin allait de l’hypophyse vers l’hypothalamus. Cette conclusion était essentiellement basée sur le fait que lorsqu’ on clampait la tige, les vaisseaux gonflaient du côté de l’hypophyse. On ne savait pas à cette époque que, contrairement à la plupart des mammifères, il existe chez le lapin une irrigation artérielle directe de la pars distalis.
Il revient à Wislocki & King d’avoir, six ans plus tard, démontré que le flux sanguin porte coule de l’hypothalamus vers l’hypophyse. Ils injectèrent des colorants vitaux dans le ventricule cérébral et observèrent que l’adénohypophyse et l’éminence médiane, mais pas le reste du cerveau, étaient colorées. Ils décrivirent les artères hypohysaires supérieures qui se forment à partir des artères carotides internes supraclinoïdes et les vaisseaux du cercle de Willis. Les artères hypohysaires supérieures font une bifurcation, envoyant une branche vers la pars distalis et l’autre vers la tige infundibulaire et le lit primaire de capillaires au niveau de l’éminence médiane. Le flux s’écoule ensuite vers la pars distalis par l’intermédiaire du lit capillaire secondaire. De la pars distalis, le flux s’écoule ensuite dans les veines hypophysaires latérales dans le sinus caverneux adjacent.
Parallèlement, Wislocki & King décrivirent l’irrigation du lobe nerveux par les artères hypophysaires inférieures, du segment intracaverneux des artères carotides vers l’excroissance infundibulaire de la glande et les veines inférieures hypophysaires. La fonction du lobe nerveux avait été déterminée de 1924 à 1936. Starling & Verney avaient montré que des extraits post-hypophysaires corrigeaient le diabète insipide, diminuaient le flot urinaire et augmentaient les concentrations en solutés urinaires. On savait depuis longtempts que le lobe nerveux régulait la pression artérielle et stimulait les contractions utérines. Enfin, Ingram et son équipe avaient montré que la transection du tractus supra-optico-hypophysaire entrainaient un diabète insipide, l’atrophie de la neurohypophyse et des dégénerescences des neurones du noyau supraoptique.
Quatrième étape : la neurosécrétion
Il devenait apparent que des neurones régulaient d’une manière totalement nouvelle la libération d’hormones à partir de l’hypophyse. En se fondant sur les colorations Gomori-positive des vésicules “colloïdes”, qu’ils avaient observées dans les terminaisons nerveuses du système neurosécréteur chez l’insecte et ayant compris que le lobe nerveux présentait une connexion veineuse directe vers la circulation générale, Ernst Et Bertha Scharrer proposèrent que les sécrétions neurohypophysaires étaient produites dans l’hypothalamus, transportées au lobe nerveux, et libérées dans la circulation. Au début des années cinquante Du Vigneaud et ses collaborateurs confirmèrent l’hypothèse des Scharrer en caractérisant les hormones peptidiques neurohypophysaires responsables des contractions utérines (Ocytocine) et de la réabsorption d’eau au niveau du rein (vasopressine). Il fut plus tard démontré que ces deux neurohormones étaient produites par les neurones magnocellulaires des noyaux paraventriculaire et supraoptique hypothalamiques.
De la fin des années 40 au début des années 60, Green et Harris puis Nikitovitch-Winer et Everett entamèrent une série d’expériences physiologiques pour démontrer que le concept de neurosécrétion s’appliquait également au contrôle des sécrétions adénohypophysaires. Des adénohypophyses de rattes femelles adultes furent autogreffées sous la capsule rénale où elles perdirent leur capacité à sécréter les hormones hypophysaires, sauf celle de prolactine. Quelques semaines plus tard, les greffes furent ré-implantées sous l’éminence médiane. Des cycles oestriens réapparurent chez la plupart des animaux dont les greffes avaient été revascularisées à partir de l’éminence médiane et dans plusieurs cas les animaux devinrent fertiles et mirent bas. Les sécrétions d’ACTH, de GH et de TSH furent restaurées en partie, alors que les greffes conservées sous la capsule rénale continuaient à sécréter essentiellement de la Prolactine. Parallèlement, Benoit et Assenmacher, tiraient avantage de la vascularisation particulière du complexe hypothalamo-hypophysaire chez le canard domestique, où le système porte hypothalamo-hypophysaire est, contrairement aux mammifères, anatomiquement séparé de la tige hypophysaire, pour confirmer en quatre opérations neurochirurgicales élégantes (cf figures) la théorie neurohumorale de Green et Harris.
Dans les années soixante, après avoir montré que seule les hypophyses greffées dans l’hypothalamus étaient capables de survivre, Halasz mis au point une technique de séparation chirurgicale entre l’hypothalamus médiobasal et l’hypophyse et le reste du cerveau. Il définit ainsi la zone hypophysiotrope, incluant l’éminence médiane, le noyau arqué, une portion du noyau ventromédian, le noyau périventriculaire, les noyaux prémammillaire et mammillaire médian et l’aire rétrochiasmatique. Toutes les afférences à ces ilots hypothalamiques étaient coupées mais la trophicité de l’hypophyse et les sécrétions hypophysaires de base étaient peu perturbées. En revanche les influences modulatrices centrales, comme la réponse des surrénales au stress et le cycle oestrien, étaient abolies.
L’éminence médiane était devenu le point focal où convergeaient les influences centrales en provenance du cerveau pour être relayées par un lien humoral vers l’adénohypophyse.
Cinquième étape : les neurohormones hypothalamiques
A partir du milieu des années 50, Guillemin et Schally entamèrent ce qui a été appelé la course au Nobel. Avec des stratégies quasi-militaires, ils collectèrent puis purifièrent des centaines de milliers d’hypothalamus ovins et porcins, respectivement (le choix d’espèces différentes permettait la publication dans tous les cas…) Puis ils évaluèrent les activités des extraits hypothalamiques dans des dosages biologiques plus ou moins “spécifiques” de chaque fonctions adénohypophysaires. Après l’époque héroïque des dosages biologiques (Jabot de pigeon pour la prolactine, croissance du tibia pour la GH, etc…), le développement des dosages radioimmunologiques des hormones hypophysaires et des techniques de purification sur gel, puis celui des cultures de cellules en monocouche et de la spectrométrie de masse leur permirent d’aboutir à la séquence peptidique du TRH (1969), du GnRH (1971) et de la somatostatine (1972). Quelques années plus tard Wylie Vale, un des élèves de Guillemin, utilisa la même stratégie pour caractériser le CRH (1981). Enfin, à partir de tumeur pancréatique, l’élève et son mentor révélèrent la séquence du GHRH (1982). Seul le Prolactin Inhibiting Factor n’est pas un peptide. Il s’agit d’une monoamine : la Dopamine.
En guise de conclusion
Au milieu des années quatre vingt, le décor (l’axe hypothalamo-hypophysaire) était planté. Les rôles principaux (les neurohormones hypothalamiques et les hormones hypophysaires) étaient distribués. Le spectacle neuroendocrinien prit alors de l’ampleur. Il n’a pas cessé de se jouer depuis. Il ne se passe pas d’année sans que de nouveaux acteurs entrent en scène. Le dernier en date, qui vient juste de sonner à la porte, est le Ghrelin. C’est un peptide stomachal de 27 ou 28 acides aminés, n-octanoylé en position 3 sur une sérine, qui semble être un (le ?) ligand endogène des récepteurs des GH-secrétagogues. Ces peptides et peptidomimétiques avaient été développés par les pharmacologues dès la fin des années soixante-dix, et leur(s) fonction(s) physiologique(s) restai(en)t mystérieuse(s), en l’absence de ligand endogène.
Par ailleurs, les connaissances accumulées en neuroendocrinologie expérimentale ont débouché sur des applications cliniques. En particulier, le traitement des adénomes hypophysaires. fait désormais intervenir des molécules à durée de vie augmentée, analogues des neurohormones inhibitrices dopamine, pour la prolactine et somatostatine pour la GH. Trois mille quatre cent ans après Akhénaton, l’aventure de la neuroendocrinologie continue !!!
Figure 1 : Vascularisation du complexe hypothalamo-hypophysaire du canard domestique
N.S., Noyau supraoptique ; 3eV, 3eme ventricule ; F.N. fibres neurosécrétoires ; RES.CAP., réseau capillaire ; CAR.INT., carotide interne ; P.N., pars nervosa ; P.D., pars distalis.
Figure 2 : Schéma des quatres types de lésions du complexe hypothalamo-hypophysaire et de leur retentissement sur le développement testiculaire, chez des canards impubères exposés à la lumière (d’après Assenmacher, 1958, Arch. Anat. micr. et Morph. exp., 47: 447-572)
C.P., Commissure palléale ; C.A., commissure antérieure ; N.S.O., Noyau supraoptique ; N.P.V., noyau paraventriculaire ; 3eV, 3eme ventricule ; C.O., chiasma optique ; T.I., décussation du tractus infundibulaire ; P.N., pars nervosa ; P.D., pars distalis ; V.P., veines portes ; Lettres fléchées de haut en bas : lésion de l’hypothalamus antérieur ; section de l’éminence médiane ; section du tractus porto-tubéral ; section de la tige infundibulaire.
Références :
Benoit J. (1974) Mes recherches en Neuroendocrinologie. Etude du réflexe photo-sexuel chez le canard domestique. publié en anglais dans le livre Pionneers in Neuroendocrinology. Donovan B, Mc Cann SM, Meites J, eds. Plenum Press (New York London)
Benoit J. & Assenmacher I. (1955) Le contrôle hypothalamique de l’activité préhypophysaire gonadotrope. J. Physiol (Paris) 47 : 427-567.
Everett JW (1994) Pituitary and Hypothalamus : Perspectives and Overview,. In Physiology of Reproduction 2nd edition E. Knobil & J.D. Neill eds. Raven Press N.Y. p.1509-26.
Kojima M. Hosoda H., Date Y., Nakazato M., Matsuo H. and Kangawa K (1999) Ghrelin is a growth-hormone-releasing acylated peptide from stomach. Nature 402: 656-60.
Wade N. (1980) The Nobel duel (la course au Nobel).
Page R.B. (1994) The Anatomy of the Hypothalamo-Hypophysial Complex. In Physiology of Reproduction 2nd edition E. Knobil & J.D. Neill eds. Raven Press N.Y. p.1527-1619.